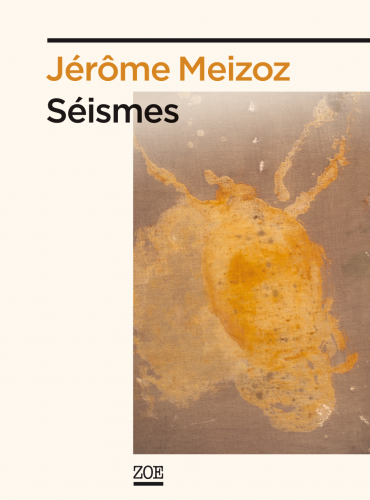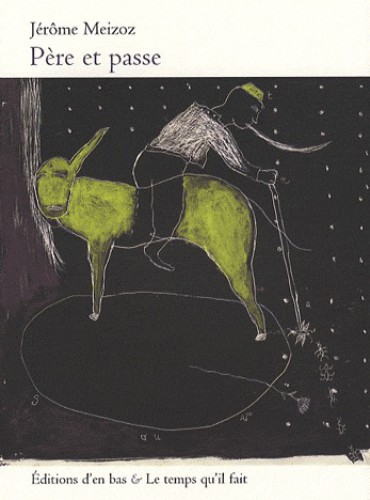Jérôme Meizoz
Originaire de Riddes, (Valais, Suisse) Jérôme Meizoz est le cadet d’une fratrie de cinq enfants. Il grandit à Vernayaz (Valais, Suisse) dans une famille politisée de gauche. Il effectue ses écoles gymnasiales au Lycée-collège de l’Abbaye de Saint-Maurice. Il en garde des souvenirs marquants. Après des études de lettres à l’Université de Lausanne, achevées par un mémoire de master sur Jean-Marc Lovay, il part étudier la sociologie à Paris, où il suit les cours de l’écrivain-sociologue Pierre Bourdieu, qui préfacera sa thèse. Devenu docteur ès lettres en 2000, il enseigne un certain temps à Zurich, puis à l’Université de Genève, où en tant que chargé de cours suppléant, il donne en hiver 2000-2001 un séminaire consacré à Maurice Chappaz. A la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, il est directeur de la Formation doctorale interdisciplinaire et enseigne aussi la littérature française.
Jérôme Meizoz publie d’abord des études littéraires en lien avec la littérature romande, puis élargit son domaine à la littérature francophone du XVIIIe (Rousseau) et XXe siècles. Il mêle rapidement approches sociologiques et littéraires. Il exerce également une activité de chroniqueur littéraire dans plusieurs revues suisses et françaises. Considéré comme un spécialiste de Charles Ferdinand Ramuz, Jérôme Meizoz participe à L’histoire de la littérature en Suisse romande de Roger Francillon (vol. 3 et 4) (Payot, 1998-1999) et collabore à l’édition critique des romans de Ramuz dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard).
Jérôme Meizoz écrit également des récits de fiction, aux titres brefs et peu joyeux, constellés de faits autobiographiques. Après Morts ou vif, qui obtient la mention « Livre de la Fondation Schiller 2000 », les Editions Zoé publient un recueil de petites proses, Destinations païennes. La revue Europe (septembre 2000) et la Revue de Belles-Lettres (no. 3-4, 2000) ont donné en prépublication quatre proses issues de ce recueil. Elles ont fait objet de lectures publiques, dans une mise en scène de François Marin, au Festival de la Cité (Lausanne, 11 juillet 2000) ainsi qu’au théâtre de l’Alambic (Martigny, 13 novembre 2000).
Jérôme Meizoz reçoit le Prix d’encouragement artistique du canton du Valais en 2000. Il fait partie de la Fondation Ramuz, du Groupe d’Olten et de Pro Litteris. En 2003, paraît aux éditions d’en bas Jours rouges, libre évocation du parcours militant de Paul Meizoz (grand-père de l’auteur, 1905-1988) dans les luttes sociales des années 1930 à 1950. Jérôme Meizoz dans la postface qu’il rédige revendique pour son texte la place d' »acte mémoriel » face au manque de mémoire littéraire dont « pâtit le mouvement ouvrier ».
(source Wikipédia)
livre(s) sélectionné(s)
Absolument modernes !
paru aux éd. Zoé, 2019, 160 pages
À la fin d’Une saison en enfer, Rimbaud proclame qu’il « faut être absolument moderne ». Jérôme Meizoz se saisit des mots du poète et par l’intermédiaire de son double, Jérôme Fracasse, évoque son Valais natal où pendant la période des Trente Glorieuses on aspirait à être « absolument modernes ! » L’ironie est d’emblée signalée par le point d’exclamation : il s’agit non seulement de rappeler cette volonté mais aussi d’en dénoncer les dérives. Entre le paradis et l’enfer de la croissance, il n’y a qu’un pas.
Il y a en effet de quoi porter un regard à la fois navré et amusé sur la mue des paysages, des mentalités et des institutions pendant les années1950 à1980. La modernité apporte son lot de promesses et la consommation devient euphorique : les innovations s’offrent à toutes les classes de la population qui, dans un bel élan et dans une sorte de « folie collective », entonnent en chœur le « chant de la croissance ». La famille du narrateur participe à cet optimisme: on s’émerveille devant les innovations techniques présentées lors de l’Exposition nationale de 1964, on salue la venue de la télévision, la construction de l’autoroute (même s’il faut céder les abricotiers de la mère), les nouvelles voitures, les centres commerciaux, le walkman. « La machine à profit » contamine aussi le langage : la grande usine de la vallée où l’on travaille à la chaîne porte fièrement le nom de « Moderna » et l’on se rend au « MODERNE » pour voir des films porno.
Aujourd’hui l’horizon a changé. Le discours sur la modernité a évolué et l’on sait que le progrès n’est plus seulement heureux. La croissance a ses revers et, tel le corbeau planant sur les têtes, elle véhicule de mauvais présages. Le narrateur mesure les incohérences de notre époque et, comme beaucoup, il peine à trouver du sens à ce qu’il observe. Mais alors que faire : revenir aux anciennes superstitions, à « la pensée sorcière » ? Refuser tous les avantages de la modernité pour s’isoler dans la nature et retrouver la « litanie des sommets et des vallées » ? Il est pris dans ses contradictions : est-il prêt à changer ? Et qu’aurait-il à gagner ? La croissance a certes asservi les individus, mais ne les a-t-elle pas aussi libérés ?
Le récit est composé de 13 chroniques suivies de 13 portraits d’anges. Jérôme Meizoz cultive l’art du montage, du fragment qui correspond à sa vision de l’état du monde : un monde morcelé à l’identité bousculée et parfois fracassée. Seule la multiplication des points de vue et des témoignages peut permettre de rappeler ce qui s’est joué dans le Haut Val de son enfance, d’effleurer ce qui est s’efface, d’essayer de dire ce qui est tu ou oublié.
Les chroniques mêlent des réflexions personnelles à des documents d’époque, des articles de presse, des études d’historiens et des textes d’écrivains. Le narrateur se présente comme « un professionnel de la mémoire publique ». Les souvenirs personnels et familiaux abondent également, souvent en lien avec la figure du père qui a salué avec enthousiasme l’abondance nouvellement offerte et qui, en bon socialiste, a cru que les produits de la croissance profiteraient à tous. Le ton se fait plus ironique, voire sarcastique lorsqu’il évoque ceux à qui profite vraiment la modernité : les Oligarques « reniflent le futur » pour se tenir toujours du bon côté du vent et les Entrepreneurs, forts de leur bonnes relations, bétonnent à un rythme accéléré. Ils dansent sur la piste de l’abondance : les mains se serrent et l’on se remplit les poches. Quant à Dieu, il demeure sur son nuage et constate que tout est bien.
Heureusement la terre est peuplée d’anges, ceux que le narrateur appelle à l’aide « pour ne pas être celui qui éteint la lumière en partant. » Les 13 anges appartiennent à son passé dans le Haut Val. Un ange « n’a pas de main pour agir dans le monde », il ne peut rien contre la misère et le malheur, mais, telle la pianiste qui donnait des cours aux enfants du village, il a « l’art d’éplucher les âmes ». Autant de portraits de vies simples, laborieuses, de vies que le monde moderne a reléguées dans l’isolement ou l’oubli. Des vies faites de moments de honte et de fierté, des vies à la marge du pouvoir et de la réussite. Des anges que l’enfant devenu écrivain n’a pas oubliés.
Au terme de cette lecture, on s’interroge sur la place que l’on attribue au bien-être dans une société qui se veut résolument moderne. On se demande comment trouver son équilibre dans un monde qui nous dépasse, qui va plus vite que nous et qui menace constamment de nous éloigner de l’essentiel.
Anne Zanoni-Jeanrenaud
Séismes
paru aux éditions Zoé, 96 p., 2013
Jérôme Meizoz est un styliste de flamme dont les phrases éblouissent. On s’étonne devant ces mots, comment peuvent-ils convoquer autant? Comme des petites boîtes qui s’ouvriraient sur des vallées endormies. Ou des grains de mica qui pourvoient en éclatant une énergie gigantesque. On revient en arrière, on relit. Et se déploient de nouveau, plus fortement encore, les silences intimes, les chocs successifs qui font devenir grand un petit garçon de 9 ans dans le Valais des années 1970. Et qui, à 20 ans, l’obligent à rompre. A provoquer la scission.
Séismes, bref roman en 24 tableaux, suit un enfant, de la stupeur face au suicide de sa mère au refus de faire son service militaire. A suivre ce parcours raconté à la première personne par un narrateur devenu adulte, s’impose la Suisse des années de Guerre froide, telle qu’en ses mythes et réflexes dans un bourg valaisan. On devine les années 1970 par les déclarations à la télévision d’un politicien sur l’argent sale qui dort dans les coffres des banques et rampe sous les pieds des passants des villes. Il y a aussi la visite, l’été, en camionnette VW, du cousin est-allemand d’un voisin de la famille.
L’apprentissage du garçon nous parvient par bouffées de souvenirs, magistralement ciselées, minimes dans leur réalité, colossales pour celui qui les vit.
Ces micro-tableaux laissent apercevoir puis constituent au bout du compte la grande chape contre laquelle le narrateur bute à la fin. Mythe du pays préservé des guerres, culte de l’ordre, place de l’armée, commandements de l’Eglise: le petit garçon soupèse ces affirmations d’adultes, les confronte à ses propres questionnements puis les dépèce, sans avoir l’air d’y toucher, en les éclairant sous une lumière d’étrangeté.
Ainsi du culte de l’Etat observé par le père qui voit dans l’enceinte du Service des automobiles le temple de son adoration. L’octroi d’une plaque et plus encore d’un numéro vous assure un ordonnancement dans le grand Tout.
Ainsi, et c’est une scène d’anthologie, de l’obligation de rendre visite aux nécessiteux les jours de fête. A Pâques, c’était au tour de Madame Rose, considérée comme «folle perdue» par tous mais à qui la mère du narrateur s’adresse comme à chacun, passant au-dessus de l’odeur de fleur fanée et de pisse qui règne autour d’elle. Le baiser que le garçon, au sommet de l’effroi, est obligé de donner à la matrone nauséabonde est inoubliable.
Ce roman d’initiation ne serait pas complet sans les illuminations sexuelles qui traversent l’adolescent au détour d’un film ou au gré des apparitions de Madame Vanier, perchée sur des talons interminables, qui tient avec son mari un magasin d’électroménager.
Dès l’entame du récit, le drame se noue au concret le plus terre à terre. Manière de dire qu’il n’y a pas place pour les émotions. Ainsi va la première phrase: «Quand mère s’est jetée sous le train, il a bien fallu trouver une femme de ménage.» Tout semble être dit dans ces quelques mots. L’océan de silence, l’impératif de faire. Le chagrin doit être épousseté, aussi lourd soit-il. «Je suis plein d’une tristesse qui fermente en silence comme un vin abandonné», glisse le narrateur nouvellement orphelin.
Le sursaut arrive inopinément. Faire le service militaire n’est plus possible tout simplement. Ce refus provoque un rêve, rendu par une écriture souple comme la matière même des rêves.
Séismes est le septième livre de fiction de Jérôme Meizoz. Reparaît parallèlement, en mini Zoé, Destinations païennes, recueil de proses publiées en grand format en 2001. Où l’on retrouve cet art de la concision. Avec ces images qui saisissent comme celles contenues dans le récit d’ouverture, «A demi né seulement». Un enfant obligé de rester au lit à cause d’une fragilité maladive perçoit tout juste les bruits du dehors. Il aimerait, parfois, s’aventurer à l’air libre. Mais le médecin l’interdit. «Pour l’instant, je reste donc étendu, à habiter toute la coupole de mes paupières. Peut-être qu’elle commencera demain, cette vie dont on me parle tant.»
Lisbeth Koutchoumoff, Le Temps
Edition 2010-2011
Fantômes
paru aux Editions d’en bas, 80 pages, 2010
C'est une oeuvre à deux mains, celles de Jérôme Meizoz, écrivain et sociologue, et du peintre Zivo. Dans un atelier à Lausanne, ils ont écrit et dessiné les récits en creux des souvenirs d'enfance du narrateur. Comment parler du moment où la mort a frappé, un jeune frère, puis une mère, comment parler de ces fantômes qui nous habitent ? Dans cette plongée en eaux profondes, Fantômes est une belle réussite littéraire et esthétique. Parce qu'ils se sont rejoints tous deux sur cette frontière trouble de la mémoire des disparus, prêts à exhumer un monde enterré. Zivo n'a pas illustré Fantômes, mais rendu l'esprit de cette oeuvre particulière. Ses dessins délicats et denses, sans noirceur, laissent toujours de la place au lecteur pour incarner les personnages.
Après Père et passe consacré à son père vieillissant, Meizoz retourne ici dans son village natal du Valais, où plusieurs générations de sa famille se sont succédé. Le recueil s'ouvre sur un Mardi Gras, où festoient les revenants - " Pour une fois que le village n'avait pas l'air d'une fourmilière abandonnée ! ". Voilà retrouvés le fils perdu, Michel le pêcheur emporté par sa besace trop lourde, et les trois soeurs italiennes mortes de tuberculose, " Tous leurs visages, intacts ! Comme leur forme visible m'avait manqué ! ". La nouvelle " Quatre, cinq, six, sept " exige à elle seule d'ouvrir cet ouvrage. Sans que rien ne soit jamais dit, lors de ce repas familial où l'on attend le retour du frère pour " rejoindre les plats fumants ", plane l'ombre de l'irréversible. " (...) nos questions se cognaient à la vitre. Le retour imprévu nous laissait sans voix, on avait lâché nos jouets. " Le texte file comme du sable entre les doigts, ne laissant de tangible dans ce monde où tout s'enfuit, que des êtres trop tôt enlevés. Jérôme Meizoz sait suspendre le temps, ou l'étirer à volonté. Entremêlés aux dessins habités de Zivo, les jetés d'écriture de Meizoz creusent un sillon profond qui " vous entre dans le corps peu à peu ".
Virginie Mailles Viard, Le Matricule des anges
Edition 2009-2010
Père et passe
paru aux éditions d’en bas & Le temps qu’il fait, 77 pages, 2008
Toi, tu as de la chance, si les Russes viennent, ils te feront rien ! " Ainsi parlait-on au père dans le village du Valais. On le surnommait " le rouge ". Mais le père vieillit, son espace de vie s'amenuise, ses pas se font plus lents. Alors le fils écrivain fait ce qu'il sait faire. Ce qu'il a déjà fait d'ailleurs dans Jours rouges, un itinéraire politique, consacré à son grand-père Paul Meizoz, militant syndical et le premier président de commune socialiste du Valais. Jérôme Meizoz reprend donc sa plume, et du " fil de l'écriture " rejoint celui qui fut si " vivant, robuste, affairé ". Le nouvel opus de l'écrivain suisse est entièrement consacré à son père, ou plutôt à la projection de son imminente disparition. Comment l'approcher cette figure paternelle, et la retenir de ce côté-là des vivants ? Les courts récits s'enchaînent, et dans cette " chambre de papier " où défilent des moments de vie, peut enfin se poser le souffle autrefois vigoureux.
S'il avance pas à pas, l'écrivain n'en dessine pas moins un portrait sanguin, d'où émane une force animale, " Je voyais son corps vif, rougi, taché, colossal, ses mains puissantes, son large cotzon de boeuf ". Le père fut un enfant sauvage, rétif à l'enseignement scolaire, un ardent défenseur du bien public, un être mutique qui aimait suivre le fil des saisons à l'aune des arbres fruitiers et réciter des poèmes les soirs de banquet. Mais une succession de décès, évoqués en filigrane au cours des récits, se chargera de briser de l'intérieur celui qui fut " un boxeur. Je le sais. Pourtant jamais de gants, de ring, d'adversaire visible (...). Il pourrait vous écraser d'un coup. " L'adversaire invisible, c'est la mort qui frappe à tout va, qui enlèvera un frère, la mère Nanette, un grand-père. L'appartement familial autrefois ouvert à tout vent, se ferme, les rideaux se baissent, la télévision ne s'éteint plus. Par le choix du fragment, des ellipses temporelles, de la retranscription de ses rêves, Meizoz ouvre l'espace confiné dans lequel s'enferme petit à petit le vieil homme, - " Une horloge sans ressort, un grand fauve éteint " - et chaque récit est un coup porté au huis clos de la vieillesse.
Le narrateur suit le rythme naturel, syncopé des souvenirs : " Préférer les éclats d'une constellation à un récit de fausse cohérence ". Il offre une image parcellisée des instants, qui ne connaît aucune chronologie, ni linéarité. Chaque texte se suffit à lui-même et participe au tout. Il procède par touches successives, y dépose ses mémoires : visions de l'enfant qu'il fut, ou de l'homme qu'il est devenu. Des instantanés d'enfance, des souvenirs salés de vacances à la mer, des portraits " en gloire " du père les bras chargés de fruits, " souriant comme un gosse sous son chapeau de paille ", ou qui, mallette en cuir sous le bras, part mener son combat socialiste, guidé par sa " Révolte de voir "les gros bouffer tout le gâteau" ". Le patriarche est pris dans les raies d'une écriture poétique et cinématographique qui lutte contre l'oubli, " Je le vois, pâle déjà, tituber vers sa ligne d'horizon, et je n'ai que ces mots pour lui faire bonne escorte. " Le narrateur se confronte pour la première fois peut-être dans Père et passe à un deuil " programmé ". Au-delà du récit mémoriel des précédents ouvrages, - comme Morts ou vif - il livre un hymne à la vie.
Virginie Mailles Viard, Le Matricule des anges
les inédits
Dix-sept ans
« Quelque part en Ecosse, Jean-Marc Lovay achevait Le Convoi du colonel Fürst. »